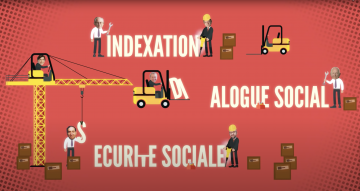F comme faits divers, faux, femme, freelance

« Projet cartel », ce documentaire de « Forbidden Stories » présente le travail du réseau de journalistes internationaux qui enquête sur les redoutables cartels de la drogue mexicains depuis l’assassinat de la journaliste Regina Martinez Perez, en 2012.
Il y a de nombreux thèmes au menu de la lettre F de notre abécédaire du journalisme.
Faits divers. Depuis ses débuts, la presse s’est délectée des faits divers comme autant de pièces du théâtre de la vie. Non seulement pour en faire de petits romans moralisateurs mais aussi, souvent, pour y épancher une vision stéréotypée de la société. Le fait divers est bien entendu alimenté par les drames de la pauvreté sociale et son cortège d’alcoolisme, de viols, de vols et de violences armées. Un moyen pour les lecteurs bourgeois (les seuls qui pouvaient se payer le luxe d’acheter des journaux) de conforter leur sentiment de supériorité. La presse se démocratisant, il fallait attirer vers elle un plus grand nombre de lecteurs et lui servir non pas des faits assortis d’une analyse de la société et de ses injustices mais des faits divers exacerbant le voyeurisme des lecteurs plus que leur analyse critique.
Il est étonnant que depuis les années 70 et l’émergence d’un journalisme plus critique accompagnant une justice qui se remettait elle aussi en question (voir investigation), on ait vu revenir un modèle de récits de faits divers du siècle précédent. L’affaire Dutroux en a été le révélateur : des journalistes se sont substitués à l’enquête judiciaire au lieu de se cantonner à leur véritable rôle d’observateurs critiques de celle-ci, certains abandonnant tout notion de distance (objectivité) pour devenir les porte-paroles des « mouvements blancs » de citoyens émus par le drame des fillettes assassinées et cherchant une explication rationnelle à l’inexplicable : la simple cruauté d’un psychopathe avéré ne suffisait pas. Il fallait démontrer des complicités au sein de la police, de la gendarmerie, du système judiciaire et donc porter le discrédit sur l’ensemble du système. Une vague populiste attisée par une certaine presse qui a vu effectivement ses tirages monter de manière très significative. Et l’on a vu prospérer les théories dramatiques de réseau de pédophiles, avec personnes « haut placées » et bien entendu protégées par l’institution… Toutes choses qui n’ont jamais vu le commencement d’une preuve mais qui étaient alimentées par les rumeurs complaisamment colportées par ces « journalistes blancs » qui dénigraient la presse « sérieuse » celle qui, courageusement et au risque de perdre des parties de son audience, exposait les faits et les critiques objectives des dysfonctionnements de la justice et de son bras armé, les enquêteurs judiciaires.
La France a connu l’hystérie de l’affaire d’Outreau et la presse, pressée par sa perte d’audience, a « mis le paquet » sur cette sordide affaire servie en cela par une justice qui a démontré en l’espèce sa cruelle incompétence. Ainsi, sur base de fausses dénonciations, des familles entières accusées de viols d’enfants, ont été dévastées psychologiquement et financièrement : des gens accusés à tort ont perdu leur emploi, ont été emprisonnés de longs mois, cloués au pilori par une presse qui n’a rien vérifié des allégations mensongères portées contre eux et qui se livrait à un portrait misérabiliste de cette population sinistrée socialement. Car au moment où se déroulait ce lynchage médiatique, une usine fermait ses portes dans la région et mettait 700 personnes sur le pavé, sans pour autant attirer l’attention des médias.
Dans le Monde Diplomatique de décembre 2004, Gilles Balbastre (1) écrit : « Accusée de connivence avec les pouvoirs et avec l’argent, quoi de plus stimulant pour elle (la presse) que de livrer bataille contre la moralité forcément décadente des notables. Le bouleversement de la donne politique, le ralliement de la gauche à des orientations néolibérales, l’uniformisation des programmes économiques ont créé un vide en matière d’affrontements idéologiques. A la lutte des classes peut alors se substituer la lutte des mœurs. Dans un espace politique en partie dépolitisé par les journalistes, les médias amplifient ces combats qui donnent le change. Et, surtout, ceux qui entretiennent l’illusion d’une presse relayant encore la voix des faibles. »
1. Réalisateur et coauteur de « Journalistes au quotidien » et « Journalistes précaires », Le Mascaret, Bordeaux, 1995, 1998).
Etre femme journaliste est à la fois un avantage et un désavantage. Il est clair que dans des médias privés, ce fut une longue lutte pour s’imposer. Et cela au prix de lourds sacrifices. En Belgique dans les années 1970, il y avait à peine une dizaine de femmes journalistes professionnelles travaillant dans des quotidiens. La télévision de service public s’ouvrit plus rapidement à ces collaboratrices qui pouvaient ainsi bénéficier du statut de fonctionnaire qui, à cause du combat syndical, permettait tout de même aux femmes de travailler en toute égalité avec les hommes. Quand j’ai débuté, en 1972, au journal La Cité, ce titre avait proportionnellement le plus de femmes journalistes de la presse écrite belge francophone : nous étions quatre sur une rédaction d’une quinzaine de personnes. A l’époque, La Libre Belgique par exemple ne voulait pas de ces « trublionnes » qui pourraient perturber les hommes de la rédaction !
Il ne s’agissait pas pour nous de traiter de sujets dits féminins. Nous étions mises à toutes les sauces, grands reportages compris, dans les mêmes conditions de précarité financière que les hommes car notre journal était loin d’être riche. C’est ainsi que j’ai fait le « marbre » : le service du soir, pendant des années. Il fallait diriger l’équipe des metteurs en page et suivre le rythme des rotativistes eux-mêmes liés aux horaires des chemins de fer qui emportaient notre production vers les provinces. Seule femme au milieu d’une cinquantaine d’hommes : c’était un avantage. J’étais protégée par eux et c’est ensemble que nous faisions face aux coups durs : des nouvelles importantes de dernière minute qui nous obligeaient à changer la page Une et éventuellement l’une ou l’autre page intérieure. Dans les conditions d’imprimerie de l’époque, ce n’était pas simple puisque nous travaillions au temps du plomb…
Protégée aussi quand, passé minuit, nous prenions ensemble le dernier verre avant de regagner nos pénates, chez Léon ou au Meyboom, là où se réunissaient les collègues des journaux voisins : Le Soir, La Libre Belgique et surtout Le Peuple. Point de divergences idéologiques entre nous : nous commentions les nouvelles que nous venions de traiter et nous parlions de notre métier, entre journalistes de l’écrit, photographes de presse (Ah, cher Jean Guyaux qui m’a ouvert l’esprit aux particularités de son métier). Autour de nous, venaient les ouvriers des ateliers voisins, les facteurs, les policiers qui lors de leur ronde de nuit venaient chercher les exemplaires fraîchement imprimés. Cela sentait bon l’encre et la camaraderie. Au milieu de ce petit monde, chez Léon, trônait « Thereske », une ancienne des Marolles, une très vieille dame de près de 90 ans qui me chantait des chansons du début du siècle et me racontait la vie qu’elle avait connue jeune, du temps des « Bas-fonds » avant qu’ils ne fussent rasés par les bulldozers de la Jonction. Du temps où le quartier était peuplé autour d’une caserne et … des bordels. Et les méchantes langues murmuraient que « Thereske » n’avait pas fait que le nettoyage en ces lieux… Elle chantait ces chansons diffusées sur des feuilles distribuées dans les quartiers populaires, en excellent français et en marollien.
Puis, il fallait rentrer. « Thereske » à l’étage du café et moi, galamment véhiculée par un des typographes qui se relayaient pour me ramener car, faute d’argent, je n’avais pas de voiture et il était passé une heure du matin au moins… Les journalistes étaient fort mal payés à l’époque (j’ai débuté à 11.000 FB par mois) ; ils n’avaient pas d’heures supplémentaires, pas d’heures de nuit comme les ouvriers. Encore maintenant, ce métier est fort mal payé par rapport aux nombreuses prestations horaires de jour, de nuit, de week-end. Mais c’est une passion. Très difficile voire impossible à l’époque de concilier ce métier dévorant avec une vie normale de famille. La plupart des femmes de cette génération sont restées célibataires ou n’ont pas eu d’enfants. A l’époque, n’existait quasi pas cette sorte de père mutant : le père au foyer ou le papa poule ! Il est venu après.
Les femmes journalistes de l’époque étaient confrontées au sexisme général de la société tout entière. Les organisateurs de conférence de presse commençaient habituellement par un vibrant « Messieurs les journalistes » ; et nous levions le bras en clamant : « Mesdames, les journalistes », en riant. Petit à petit, nous nous sommes imposées y compris lors des reportages les plus durs et par notre solidarité entre nous malgré nos appartenances à des titres différents. Une sororité qui a été éclipsée par le dogme de la concurrence… Si je n’ai pas été confrontée au moindre sexisme dans ma rédaction, la confraternité régnait réellement, ce ne fut pas le cas ailleurs. La précarité économique a amplifié la concurrence y compris entre les sexes, la direction des médias appartient en majorité à des hommes. Une situation de plus en plus difficile pour les femmes journalistes, victimes de harcèlements divers, amplifiés par le développement des réseaux sociaux. L’Association des Journalistes professionnels a récemment lancé une vaste campagne « Zéro sexisme » dans les rédactions. (http://www.ajp.be/campagne-zero-sexisme/)
Femme journaliste, c’était aussi un concept assez difficile à expliquer à l’autre bout du monde, au fin fond des villages où je faisais du reportage social sur les actions de développement des populations locales avec des ONG et des organismes comme la Fondation Damien (à l’époque les Amis du Père Damien), l’Unicef, Oxfam et autres. Souvent les populations me percevaient comme un médecin ou une « bonne sœur ». Mais la qualité de femme me permettait d’approcher les autres femmes, ce qui était impossible pour un homme. Je pouvais les rencontrer dans leurs cuisines, dans leurs bains communs, autour du puits... Sororité qui dépassait les frontières de la langue, gentillesse et générosité de ces femmes qui n’avaient pas droit à l’expression publique et qui témoignaient en me montrant leur vie, leurs enfants, leurs malheurs et aussi leurs joies. Le plus poignant témoignage m’est venu de femmes pakistanaises, les plus persécutées des femmes dans un système patriarcal d’une dureté extrême (relayé actuellement par les Talibans en Afghanistan), battues, sans droits et qui m’offraient une broderie pour que je ne les oublie pas, pour que je parle d’elles et de leur profonde souffrance. Femmes qui ne font pas l’information : elles sont pourtant les témoins les plus importants des ratages de l’humanité. J’ai décidé alors de leur donner systématiquement la parole. C’est cela aussi le journalisme : être la voix des sans voix.
Freelance. Ce terme qui semble supposer la plus grande liberté est en réalité issu d’une histoire nettement moins glorieuse : celle des mercenaires. En effet, écrit Peter Warren Singer (2), dans Le Monde Diplomatique de novembre 2004, « la prolifération des forces militaires privées coïncide avec une instabilité croissante due à des changements politiques ou à des périodes de démantèlement des armées régulières – en particulier pendant la guerre de Cent Ans (1337-1453). L’absence d’une autorité centralisée crée alors les conditions optimales pour le recrutement de soldats privés. A l’origine, nombre d’entre eux proposent leurs services en tant que « lances libres » (l’origine du terme actuel freelance) ».
Osons une comparaison : la prolifération actuelle des journalistes freelance coïncide avec une dérégulation du métier de journaliste de moins en moins engagé comme salarié dans des entreprises de presse soumises aux lois du marché et donc en pleine crise économique et qui survivent en diminuant leur personnel, le nombre de pages, en optant pour des sujets dits populaires censés séduire un plus grand nombre de lecteurs. Les journalistes indépendants sont donc loin d’être indépendants mais contraints à une productivité à bas prix qui ne leur permet que rarement de maintenir une bonne qualité intellectuelle. Ce qui les oblige même à vendre leurs services et leurs qualités aux secteurs de la publicité et de la communication en général. Pour survivre, tout simplement. D’où une confusion de plus en plus grande entre l’information et la communication.
Ce qui ne déplaît pas aux patrons de presse car ils disposent ainsi d’une masse de jeunes, et de plus en plus de jeunes filles (précarité oblige), sortis par milliers d’écoles de journalisme et d’université, où on ne leur dit pas assez que le secteur est plein d’embûches et certainement pas très porteur économiquement parlant ! Le freelance qui veut garder son indépendance intellectuelle et son honnêteté journalistique doit parfois se reconvertir dans d’autres professions, tout en, éventuellement, continuer à collaborer à un journal, toujours à bas prix, mais alors pour le plaisir… sans la liberté.
La phase de journaliste indépendant était un passage quasi obligé avant une embauche. Et c’était intéressant puisque le jeune accumulait ainsi des expériences professionnelles dans des secteurs très divers de l’information. Cette phase est devenue tellement longue, plusieurs années à présent que beaucoup renoncent à ce métier qui, pour être une passion, doit cependant permettre de gagner son pain. Cependant, l’Association des Journalistes francophones a constitué une plateforme internet permettant à ces indépendants de mieux rencontrer le « marché du travail », de faire reconnaître la valeur de leur travail et de s’épauler les uns les autres pour des enquêtes collectives : https://www.journalistefreelance.be/
Il existe aussi depuis une dizaine d’années un Fonds pour le Journalisme qui, grâce à l’argent public, permet de financer des enquêtes, des reportages de qualité, nécessitant beaucoup de temps et des déplacements coûteux. Nombre de travaux ainsi aidés ont récolté des prix de journalisme et lancé des jeunes talentueux : https://fondspourlejournalisme.be/
2. Auteur du livre « Corporate Warriors, The rise of the Privatized Military Industry » (Cornell university Press, New York, 2003)
Faux. J’ai même connu de jeunes journalistes, des stagiaires étudiants être obligés d’écrire ou de dire des faux parce que l’information qu’ils récoltaient selon les règles déontologiques qu’ils venaient d’apprendre n’était pas assez croustillante pour appâter le lecteur-auditeur-téléspectateur. Il est arrivé qu’un rédacteur en chef ou un chef de service leur intimait l’ordre de transformer les faits en inventant de toute pièce des éléments tenant plus du roman minable que de la réalité des faits. En principe, ces jeunes devraient pouvoir compter sur la solidarité des salariés de la rédaction mais si eux-mêmes sont soumis aux pressions et menaces de leur direction, que reste-t-il pour préserver l’honneur d’une profession ? C’est ainsi que fut créé le Conseil de déontologie journalistique dont un des rôles est de protéger ceux qui veulent faire correctement leur métier. Et cela fonctionne. (Voir D comme déontologie)
La pratique du faux a connu son heure de gloire aux Etats-Unis, dans les journaux les plus réputés pour le sérieux de leur information. Ainsi, le New York Times a publié des articles de Jayson Blair qui faussait les faits, plagiait des articles qu’il récoltait sur Internet et inventait des dizaines d’histoires. Les deux patrons de la rédaction ont dû démissionner. Plus fort encore : le reporter le plus célèbre de USA Today, Jack Kelley avait inventé des centaines de récits sensationnels entre 1993 et 2003, ayant pour cadre un nombre impressionnant de pays : attentat terroriste en Israël comme s’il y était, une fuite de Cuba par bateau se soldant par une noyade… entièrement inventée. Un scandale qualifié comme le plus grand de l’histoire du journalisme américain et qui a coûté leur place à trois dirigeants de la rédaction du plus grand quotidien américain.
Enfin, le présentateur vedette du journal télévisé de CBS a été obligé de se retirer après avoir diffusé sans les vérifier de faux documents destinés à démontrer que Bush junior avait bénéficié de soutiens pour échapper à la guerre du Vietnam. Si on ne mesure pas encore l’ampleur du discrédit que ces faussaires ont causé à l’ensemble du secteur de l’information, il est déjà certain que l’audience de la presse en général est décroissante. D’autant que ces faussaires ont été démasqués au moment où la presse américaine dans sa grande majorité se laissait aller à une vague de propagande patriotique après les attentats du 11 septembre 2001 et pendant la guerre en Irak. (Voir P comme Propagande).
La pratique du faux a connu une évolution fulgurante ces dernières années, accompagnant le développement de l‘information sur le Web. Le concept de « fake news » connaît une actualité inquiétante vu son utilisation politique et économique à l’échelle du monde entier. Le monde du journalisme s’est évidemment inquiété de cette pollution, de ces manipulations de l’information qui discréditent complètement le métier. Nous en avons parlé récemment ici : https://www.entreleslignes.be/humeurs/zooms-curieux/ces-fake-news-outils-des-pouvoirs
Pour les citoyens voici quelques conseils de base : https://www.journaldunet.com/media/publishers/1490977-3-conseils-pour-contrer-la-desinformation/
De nombreux médias ont créé des outils pour lutter contre les fake news ; par exemple, Le Monde et son Décodex : https://www.lemonde.fr/verification/
- Ceci est un exercice de journalisme participatif. Appel est lancé à la mémoire des confrères et consœur afin qu’ils envoient leurs réactions, suggestions, corrections et commentaires à gabriellelefevre@entreleslignes.be. Ce qui sera publié dans cette rubrique.
Il semble que vous appréciez cet article
Notre site est gratuit, mais coûte de l’argent. Aidez-nous à maintenir notre indépendance avec un micropaiement.
Merci !
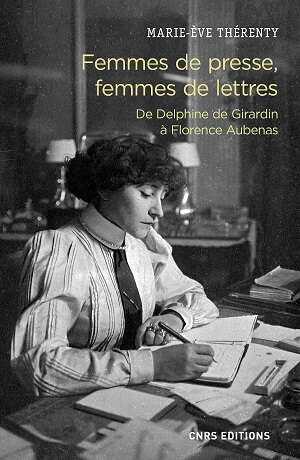
Femmes de presse, femmes de lettres. De Delphine de Girardin à Florence Aubenas, Marie-Ève Thérenty, CNRS Éditions, 2019.
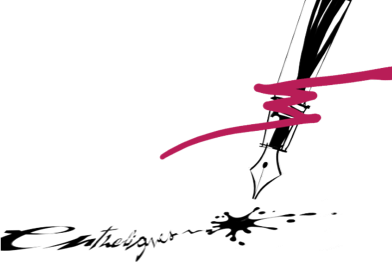
Inscrivez-vous à notre infolettre pour rester informé.
Chaque samedi le meilleur de la semaine.
/ Du même auteur /
-

Plus le choix. On résiste !
-

Solidarité urbaine : l’exemple du Village Sainte-Anne
-

Apologie du terrorisme, crie le perroquet !
-

Habiter, c’est un droit
-

Les BRICS sont-ils une alternative ?
-

Inter-Environnement Bruxelles, 50 ans de luttes des habitants
-

IA : le journaliste « parfait »
-

Un génocide en héritage
-

Rwanda, la mémoire d’un génocide
-

Palestine : la triple illégalité de l’occupation par Israël
/ humeurs /
/ photos /
/ Commentaires /
Avant de commencer…
Bienvenue dans l'espace de discussion qu'Entreleslignes met à disposition.
Nous favorisons le débat ouvert et respectueux. Les contributions doivent respecter les limites de la liberté d'expression, sous peine de non-publication. Les propos tenus peuvent engager juridiquement.
Pour en savoir plus, cliquez ici.