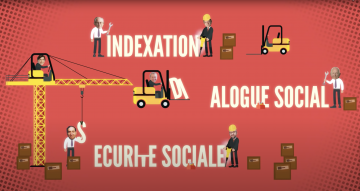Un avant dire pour autre chose.

Auschwitz Photo © Jean-Frédéric Hanssens
Quand j’étais petit, plongé dans des livres d’Histoire pour enfants de mon âge, j’apprenais confusément qu’il y avait eu des pays, des sociétés, où les femmes, les hommes, les enfants, vivaient dans la brutalité, la guerre, la pauvreté, la mort. Je passais mon temps à les imaginer, ces pauvres gens, avec leurs vêtures pitoyables, dans le froid, cherchant une maigre subsistance dans des ruines fumantes. J’imaginais les princes et leurs faces atroces, et leurs crimes, et les bûchers absurdes. La Peste noire, l’Europe dévastée. Les soldats blafards des colonies et les villages africains écrasés de terreur. Les chevaliers féroces, les patriciens romains qui applaudissaient au martyr des vaincus, les empereurs Hans et leurs raffinements inouïs de cruauté, les grands Incas qui sacrifiaient des adolescents, les Cosaques assoiffés de sang juif, les tranchées infernales du Chemin des Dames, la guerre, la guerre, l’injustice, la bestialité du pouvoir, la maladie, fauchant à pleins bras les vies fragiles des humains que je devinais si proches de moi. De moi, membre d’une génération insolite d’Européens nés et grandis après la Deuxième Guerre mondiale, dans cette période rare où les malheurs semblaient réservés à d’autres. Nous étions persuadés que cette humanité de souffrance n’était pas pour nous. Toutes les autres humanités, les antiques, les moyenâgeuses, les sauvages, les ailleurs, je les mélangeais, confondais, parce qu’elles appartenaient à des univers lointains, presque impensables, et largement impensés. Un jour, c’était chez une de mes tantes, dans un petit village, où nous venions chaque année pour la Toussaints, comme de tradition dans notre famille, prendre une tasse de café, partager une tarte, parler des oncles, des cousins, des cousines, je devais avoir douze ou treize ans. Un de mes cousins, pour la ramener, montrer qu’il en savait plus que nous sur ce monde mystérieux, inquiétant, qui était ailleurs, me montra un livre sur Auschwitz. C’était un grand livre d’images. Plein de photos. D’abord, j’ai regardé, sans comprendre. Comment déchiffrer ces clichés, ces corps amoncelés, ces visages évidés, revenus de l’enfer, ces hommes gras et rieurs, photographiant des pendus. Petit à petit, s’est infiltré en moi l’idée qu’il s’agissait d’images d’une réalité qui s’était vraiment produite. Mais où, quand ? Au fur et à mesure que je tournais les pages, j’apprenais que cette réalité avait eu lieu quelques années plus tôt seulement, on était dans les années soixante de l’autre siècle, et tout près d’ici, dans un de ces pays européens qui paraissaient protégés des fléaux. Une autre idée s’est infiltrée en moi : c’est que la sauvagerie n’est ni lointaine, ni ailleurs. C’est que la sauvagerie est ici, avec moi, chez moi, chez nous. Voilà comment, avec bien d’autres choses, comme la découverte de l’angoisse, de la mort et de la sexualité, s’est faite la brisure profonde par quoi je suis né au monde réel, celui des grands. Les années soixante. Il y eut ensuite la fin du contrat social-démocrate et des garanties sociales. Le retour des droites arrogantes et des extrêmes droites voraces, des menaces de pauvreté honteuse, de misère même, dans nos propres villes. Les années quatre-vingts, nonante, les guerres yougoslaves, les catastrophes humanitaires, les racismes, et plus récemment le sort de nos sœurs et de nos frères noirs dont j’ai pu toucher de mes mains la dureté, au Maroc et à Bruxelles. La sauvagerie a définitivement reconquis son droit de citer. Comme j’ai grandi, comme mon cœur s’est caparaçonné, j’ai pu supporter ce fait. Je passe sur mes expériences intimes de détresse ou de malheur, qui n’ont rien d’exceptionnel.
Aujourd’hui, je sais. Le monde merveilleux de mon enfance a volé en éclats une fois pour toutes. J’y repense, attendri, avec une drôle de nostalgie qui me semble louche. Je revois ce petit univers tiède, protégé, au milieu des horreurs. Nous étions pauvres, mais pauvres dans les années soixante, ça pouvait vouloir dire aussi heureux, d’une certaine manière, sans faim, sans froid excessif en hiver, sans angoisse de manquer des choses essentielles, même si la blessure sociale, parfois, se rouvre, à l’idée des vêtements de paroisse, des cartables et des plumiers de seconde main en septembre… Nous étions heureux. Autour de nous, des gens mouraient, assassinés, bombardés, affamés. Un souvenir particulier. Le samedi soir, mon frère et moi avions l’autorisation de rester un peu plus tard devant la petite télé en noir et blanc, avec ses images dansantes. Pour regarder le « Jardin extraordinaire », sur l’unique chaîne disponible, la RTB. Quel univers enchanteur, que celui de ces animaux fantastiques qui s’entredévoraient en toute innocence dans des forêts de légende. Arlette, la présentatrice, était une de mes idoles. Je parlais d’une blessure sociale. C’était le sentiment de ne jamais être de la fête. D’être écarté, oublié. Différent. A l’occasion d’une Opération 11.11.11, où je vendais moi aussi mes petits gadgets de solidarité, Arlette était venue animer une après-midi dans un centre commercial, près de chez moi. C’était un grand événement. Il y avait aussi une vedette de la chanson, dont j’ai perdu le nom. Pour des raisons que j’ai oubliées, je n’ai pas pu être là, pour voir Arlette de mes yeux. Longtemps, j’ai pensé que c’était parce que j’étais différent, enfant de pauvre, avec ses vêtements rapportés, ses plumiers maculés par les craboutchinas d’un autre. Et Arlette venait parler d’enfants qui mouraient comme des mouches, en Afrique. Et les gens étaient allés la voir, demandant des autographes, achetant des petits machins humanitaires, pour les enfants qui mouraient, tout en faisant leurs courses, avec leurs caddies pleins de bouffe et d’objets superfétatoires. Et moi je m’en faisais pour ma malédiction personnelle. Et le samedi suivant, en début de soirée, Arlette était de retour avec une séquence sur les petits oiseaux des champs. Et les enfants mouraient comme des mouches. Et voilà l’étrange, étrange barbarie de ces années-là.
Aujourd’hui, que la pénurie est revenue, visible, insolente, dans nos rues, dans nos villes où la richesse est plus profuse, plus exubérante que jamais, aujourd’hui que la peur est de retour, s’exprimant de ses mille façons égoïstes ou généreuses, je suis fasciné par cette cohabitation invraisemblable de la douceur et de la l’horreur. Outre les considérations habituelles, et qui ont toute leur valeur, à propos des sociétés de consommation où grandissent les exclusions, à propos des sociétés du Nord qui continuent de piller celles du Sud, à propos des politiques de non asile qui, en Europe, prennent en otages des centaines de milliers d’hommes et de femmes africains dont la tragédie est organisée et planifiée par l’Etat… Je suis fasciné par la sorte de coexistence dont s’arrange l’humanité, entre la sauvagerie et la douceur de vivre. Pas seulement d’un pays à l’autre, d’une ville à l’autre, d’une maison à l’autre. Mais à l’intérieur des vies, d’un moment à l’autre, d’un lit à l’autre, presque d’une main à l’autre. Est-ce cela, la fameuse condition humaine ? Est-ce cela, la préciosité exquise de l’art décoratif bourgeois du dix-neuvième siècle, quand les ouvriers crevaient de travail et d’épuisement ? Et leurs petites chansons d’amour et d’espoir qui parlaient d’un temps de cerises ? Est-ce cela ? Ou est-ce que je mélange tout ? Lutte de classes, espoir, souffrance, humanité.
Il semble que vous appréciez cet article
Notre site est gratuit, mais coûte de l’argent. Aidez-nous à maintenir notre indépendance avec un micropaiement.
Merci !
Un autre souvenir. Lors d’un de nos longs entretiens, pour la rédaction de ses mémoires, Maryla Michalowski-Dyamant me parlait des conditions de survie à Auschwitz. De survie matérielle, bien sûr, mais aussi morale. Elle me racontait que, dans certains baraquements, des femmes organisaient des séances de poésie. Quasiment mortes de faim, rongées par les maladies, à tout moment menacées d’être exécutées ou brûlées, ces femmes se disaient des poèmes de Heine, de vieux poètes yiddish, se fredonnaient des chansons, en sourdine, qui parlaient d’amourettes, de jardins, d’été. Dans le ventre de la géhenne, elles vivaient comme des êtres humains. Avec le luxe inouï de la poésie et de l’espoir. De la douceur la plus extrême.
Ici, au bout de l’avenue de Stalingrad, la Ville vient d’installer un monument étrange. C’est un escalier qui grimpe et s’arrête à la bouche d’un énorme porte-voix en métal clair. On m’a dit qu’il s’agit de commémorer les immigrations, chez nous. Comme une écume tranquillisée de ces vagues de transhumances marocaines et turques qui, depuis les années soixante, celles de mon enfance, ont déposé les espérances, les déchirements, les drames d’un peuple entier de familles, de travailleurs, d’enfants perdus. Tout au bout de l’avenue de Stalingrad, dont le nom résonne encore des fracas et des abîmes d’une guerre et d’une aspiration anéantie. C’est calme, ici, on a planté des arbres jeunes, dont le vert tendre répond à une plaque qui parle de Rosa Luxemburg, dont on a donné le nom à cette allée centrale. On y mettra peut-être des bancs. Des vieilles gens viendront peut-être y déposer leurs vieux rêves. Des femmes noires passent, la tête pleine des leurs, et de soucis, sans se douter du théâtre des souvenirs et des épopées grandioses qui sommeille là. Dans les maisons alentours, des hommes survivent, traqués par l’Office des Etrangers, la hantise d’être refoulés dans des pays où ne les attendent que le désespoir et parfois la mort. Ils paient cher des logements ignobles, quand ils ne dorment pas dans les parcs, travaillent dans des caves de restaurant pour cinq euros de l’heure. Quand on les paie. C’est ici, dans ce pays où les télés diffusent une réalité doucereuse de couleurs pastel, où les gens calculent comment ils vont accumuler d’autres objets inutiles, des vêtements de marque, que les hommes qui survivent rêvent de porter aussi, d’ailleurs. Nous le savons. Notre cul rose baigne cependant dans ce mélange de torpeur tiède et d’inquiétude économique qui représente, croyons-nous, tout notre horizon. Nous sommes égoïstes, parfois hargneux, mais tendres aussi, vulnérables, blessés, et blessants. C’est à n’y rien comprendre. Voilà donc comment nous sommes faits. Que vont devenir nos rêves d’un monde différent, d’une humanité meilleure, plus douce, libérée de la sauvagerie, dans tout ça ? Que deviennent nos rêves, le matin, quand la chape du monde des grands, raisonnable et résigné, s’abat sur nous à nouveau, comme chaque matin ? Je pose ces questions. Comment pourrais-je y répondre ?
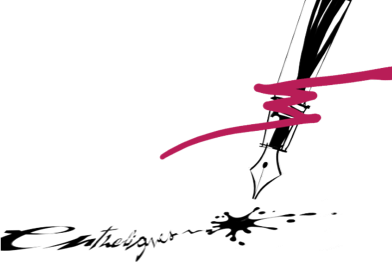
Inscrivez-vous à notre infolettre pour rester informé.
Chaque samedi le meilleur de la semaine.
/ Du même auteur /
-

Chemins noirs - Poèmes inédits de Serge Noël
-

Plage
-

Café de nuit
-

Moment de silence
-

L’arcade des mains coupées
-

Lorsque le moral est bas la ville la nuit
-

Le départ
-

Dans l’ombre et la lumière
-

Dans l’ombre
-

Petit homme
/ humeurs /
/ photos /
/ Commentaires /
Avant de commencer…
Bienvenue dans l'espace de discussion qu'Entreleslignes met à disposition.
Nous favorisons le débat ouvert et respectueux. Les contributions doivent respecter les limites de la liberté d'expression, sous peine de non-publication. Les propos tenus peuvent engager juridiquement.
Pour en savoir plus, cliquez ici.