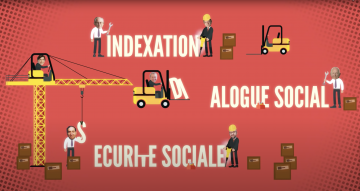Camille Detraux et la première photo du Bois du Cazier

“Avec cette image, je voulais montrer aux lecteurs ce que c’était ...” Photo © Camille Detraux
Le Musée de la Photo de Charleroi (Mont-sur-Marchienne), organise des rencontres et des tables rondes qui, chaque fois, se déroulent dans une atmosphère intimiste. Ceux et celles qui viennent aux rendez-vous fixés par le directeur Xavier Cannonne et son équipe partagent une même passion pour lire les images et en saisir le sens profond. Le jeudi 29 septembre, Camille Detraux, le premier photojournaliste arrivé au Bois du Cazier, accompagné de son ami photographe André Goethals, a confié, dans un échange simple et chaleureux, comment il était devenu l'auteur de ces images qui resteront, après lui. Parce que les photos de Camille sont imprégnées de l'essence du drame. Soixante ans après, elles vont droit au coeur et à la raison. Si nombre d' images rappellent la tragédie du 8 août 1956 et ses 262 morts, la toute première résume tout. Camille Detraux, arrivé sur les lieux très vite, est monté à l’étage d’un immeuble de la rue qui mène aux grilles de l’entrée du charbonnage pour capter toutes les dimensions de l’accident: la fumée épaisse qui nappe les lieux de gris plomb, les gens dans une attente qui sera très très longue, le drame qui se déroule, invisible, à mille mètres sous la surface.
“Avec cette image, je voulais montrer aux lecteurs ce que c’était ...” dit Camille.
Ce matin-là, arrivé au journal, rue du Collège à Charleroi, aux alentours de huit heures, il allait demander le programme quand la secrétaire de direction lui transmit un message téléphonique urgent émanant du journaliste Lucien Harmegnies. Echevin faisant fonction de bourgmestre à Marcinelle, celui-ci s’était rendu au Bois du Cazier – en pyjama-, pour évaluer l’ampleur d’un terrible incendie. Lucien Harmegnies avait appelé la rédaction mais n’aura pas écrit de papier. Il s’engagea, en tant que bourgmestre faisant fonction, dans l’organisation des opérations de sauvetage et de soutien aux familles.
“Je ne savais pas où se trouvait le charbonnage, se souvient Camille. J’ai suivi les fumées et j’ai compris que c’était très grave. C’est alors que j’ai demandé à un riverain de la rue du Cazier si je pouvais monter à l’étage pour faire cette première photo”.
Le journaliste venait d’entamer le reportage le plus important de sa vie. En raison de son intensité. Et de ce que la vision du chagrin et de la souffrance lui a laissé sur le coeur.
“J’ai photographié toute la journée durant les premiers sauveteurs, les survivants remontés à temps, les gens devant les grilles qui attendaient des nouvelles en pleurant. Un peu tout ce qui se passait. Jamais je n’avais photographié des gens qui pleuraient et je ne l’ai pas fait, même alors. S’il me fallait montrer la réalité, je le ferais sans gros plans. J’étais terriblement gêné de faire des photos, même si c’était mon métier. J’ai pris du recul. Il faut dire que j’ai su tout de suite que c’était fini. Que l’on ne retrouverait plus de vivants. Un sauveteur me l’avait dit. Et de savoir cela, quand j’étais devant les femmes et les enfants, me faisait du mal. J’allais faire des photos de gens qui espéraient et je savais que l’espoir n’était plus”.
Avec Raymond Paquay
Ces jours-là, plus rien d’autre ne figurerait au programme. Raymond Paquay, collègue reporter du Journal, en vacances à la mer, revint trois jours plus tard et fit les photos en relais avec Camille.
“Raymond est mort, nos photos on les a beaucoup demandées. Par respect pour mon collègue, j’ai toujours tenu à ce que figurent nos deux noms comme signatures”.
Si Camille n’a jamais photographié le visage d’une femme en larmes, d’autres reporters, notamment venus de France, ont harcelé les proches des victimes. Au point que plusieurs d’entre-eux furent reconduits à la gare par la gendarmerie. Camille n’a pas admis cette manière de pratiquer le reportage. Elle est à l’opposé d’un journalisme respectueux de l’être humain. De son droit à l’intimité. Il s’est évertué à faire comprendre la douleur sans franchir la limite de sa conscience. Ce qui fait de lui un grand journaliste, dont les images donnent à comprendre une tragédie.
Le parcours de ces images n’aura pas été facile. C’est grâce à une série de hasards que ces photos ont franchi les années. Restant en permanence au Cazier, Camille n’a pas ramené ses films au bureau pour les développer et imprimer les photos, comme d’habitude. C’est le photograveur Robert Franc, passionné de photo, qui vint récupérer les bobines, les développa et imprima soigneusement les négatifs. Camille, en photographe professionnel, avec son côté artisan, avait veillé, malgré la hâte et le tumulte, à la bonne exposition et au cadrage de ses images. Celles-ci ont un style intemporel, soixante années plus tard. Elles sont classiques mais lourdes de sens. L’appareil dont il se servait, Camille ne l’a jamais quitté. Il sommeille dans une armoire, c’est un Rolleicord 6x6, qui pèse au bout du bras son poids de métal et d’optique et d’images engrangées au fil des années de service.
“Ce soir-là, j’étais bien fatigué. Vers minuit je suis revenu à Charleroi pour manger au Trou Normand, le restaurant ouvert la nuit. Après, je me suis allongé par terre, dans le laboratoire du journal, pour quelques heures, avant de redémarrer pour le Cazier. J’ai continué à faire mes photos mais jusqu’à la fin, jusqu’aux enterrements, j’ai eu l’impression de revivre les images du premier jour”.
Depuis lors, de commémorations en anniversaires, les photos de Camille et Raymond ont été publiées à maintes reprises, dans des journaux, magazines, revues et livres, reprises dans des films ou à la télévision. Elles ont fait l’objet d’expositions, que ce soit au Centre historique du Bois du Cazier, à Lewaerde (France), au Musée de la Photo ou ailleurs. Hormis pour de modiques montants, Camille n’a jamais voulu percevoir de droits d’auteur. Pas question de gagner de l’agent sur le malheur des autres. Et jamais il ne s’est pris pour un grand de la photo. Il dit avoir fait son métier, le 8 août comme tous les autres jours.
Sans un autre photographe, les négatifs de Camille et Raymond auraient disparu... “André Goethals, avec qui je travaillais au Journal, qui était en faillite, a refusé que l'on jette les films du Bois du Cazier dont on se débarrassait avec des tas d’autres documents. Raymond Paquay avait conservé dans des boîtes les négatifs qui lui paraissaient importants. André Goethals a attendu plusieurs mois avant de me dire que les photos étaient encore là.”
A l’époque, les négatifs étaient jetés après un certain laps de temps. Il y avait tellement de photos, personne ne voyait en elles des témoignages du temps qui passe et d’une manière de vivre en une ville déterminée.
Raconter la vie
Né à Tamines le 16 décembre 1926, Camille a été attiré par la photographie alors qu’il était tout jeune. “J’ai très tôt aimé reproduire la réalité qui m’entourait”. Comme il n’avait pas les moyens d’acheter un appareil photo, il revendit sa collection de timbres pour acquérir d’occasion un appareil à soufflet. Il étudiait la technique dans un livre auquel il revenait sans cesse. “Je faisais des portraits des membres de ma famille, de ma mère. J’utilisais la chambre noire de mon beau-frère. Il était photographe industriel aux ACEC”.
Son premier reportage fut l’entrée en fonction d’un curé à Tamines. Et le spectacle d’un manège de chevaux de bois à la ducasse de Presles. En quelques images, il raconte une histoire... “De vieilles histoires”, comme il dit, lui qui a connu la guerre, étant adolescent et qui a vu les gens vivre de peu.
Après l’école, Camille a été boucher pendant huit ans avec son père, dans le commerce familial, à Tamines. Pendant son service militaire, à la caserne Marie-Henriette, à Namur, il exerça encore son métier. Puis il entra aux ACEC comme ouvrier. Il fabriquait des isolateurs ronds pour des transformateurs. Coup de chance, l’entreprise recherchant un photographe industriel, Camille passa de la production au laboratoire et au reportage. Il avait environ vingt-cinq ans. Il aimait ce métier, vivait sa passion au jour le jour. Malheureusement, un ingénieur pistonna une connaissance et Camille se retrouva affecté à un service qu’il n’aimait pas et il démissionna pour entrer à la Glacerie d’Auvelais. Il conduisait un pont roulant. On lui avait dit que s’il était capable de piloter sa BSA 650 cm3 (avant, il avait été le propriétaire d’une BSA 350 monocylindre), il mènerait sans problème un pont et il y arriva au premier essai.
Un an plus tard, en vacances à Bouillon, son beau-frère, qui était un collaborateur extérieur du Journal de Charleroi, l’appela: “Il y a un poste de photographe qui se libère, viens vite!”
Saisir la vie
Le lendemain, Camille entrait à la rédaction de ce quotidien qui, en 1870, refusa d’embaucher un certain Arthur Rimbaud, venu à pied de Charleville, et qui aurait voulu être reporter. Mais il avait l’air d’un vagabond, lui qui écrivait des poèmes.
Camille fit équipe avec Raymond Paquay, dont le premier reportage, à la fin de la guerre, fut celui de l’exécution de collaborateurs assassins. “ Quant à moi, chargé des reportages extérieurs, je partais en tram ou en bus. C’était difficile et long. Le journal m’a acheté une Vespa avec laquelle j’ai roulé par tous les temps, sous la neige et la pluie. C’était trop dangereux et je me suis décidé à acheter un véhicule pour travailler. C’était la Gogomobil qui m’a permis d’être le premier sur les lieux , à Marcinelle”.
Des matchs de football aux courses cyclistes et à la balle pelote, des conférences aux grèves, des faits divers aux noces d’or, des bals aux goûters de pensionnés, du palais de justice aux concerts à l’hôtel de ville, des galeries d’art aux fêtes de Sainte-Barbe et Saint-Eloi, des usines aux écoles et des mariages aux enterrements, Camille couvrait tous les événements de la ville et de la région.
“Un jour quelqu’un m’a dit que ce métier de photographe de presse était un sacerdoce. J’aimais bien mon travail mais les congés étaient rares. On travaillait toute la semaine et les week-ends et jours fériés. Il fallait des photos, on y allait. Jour et nuit. Souvent j’étais seul, sans rédacteur. Je prenais des notes sur un papier que je donnais ensuite à un journaliste. Je partais souvent aussi avec les rédacteurs qui n’avaient pas d’auto. Il était difficile d’avoir une vie de famille. Il faut le rappeler, quand on regarde les photos du Bois du Cazier. Ce jour-là, j’ai fait mon métier, comme toujours, mais plus jamais je ne revivrais un événement aussi triste”.
Il semble que vous appréciez cet article
Notre site est gratuit, mais coûte de l’argent. Aidez-nous à maintenir notre indépendance avec un micropaiement.
Merci !
Hormis la photo, et sa famille (sa fille Dominique est artiste-peintre et il est grand-père), Camille Detraux aime le sport. Il a pratiqué les poids et haltères, la course à pied et joue au tennis de table chaque semaine. Il a toujours cultivé son potager et se nourrit de manière équilibrée. Homme de bonne compagnie, bienveillant et conscient de ses actes, il garde cette manière d’être qui fit que tout le monde, à Charleroi, aimait bien" le photographe du Journal".

Camille Detraux Photo © DR / RTLINFO
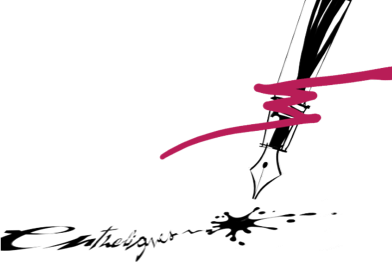
Inscrivez-vous à notre infolettre pour rester informé.
Chaque samedi le meilleur de la semaine.
/ Du même auteur /
-

Histoire liée à un passeport perdu
-

Dans l’ombre des personnages de Rothko
-

Jean-Loup Nollomont: "Rajah, mes 2 yeux à 4 pattes"
-

William "Djan Pinson" s'est envolé
-

Libramont-Matadi avec Stanislas Barberian
-

Les écoliers-reporters de la Petite Chevenière
-

L'adieu de la Wallonie à Paul Furlan
-

Au Bois du Cazier, le message humanitaire de Michele Cicora
-

"Dans l'Enclos" de Lorenzo Cecchi, 41 prénoms
-

Regard d'un chercheur sur les mécanismes de nos capteurs sensoriels
/ humeurs /
/ photos /
/ Commentaires /
Avant de commencer…
Bienvenue dans l'espace de discussion qu'Entreleslignes met à disposition.
Nous favorisons le débat ouvert et respectueux. Les contributions doivent respecter les limites de la liberté d'expression, sous peine de non-publication. Les propos tenus peuvent engager juridiquement.
Pour en savoir plus, cliquez ici.