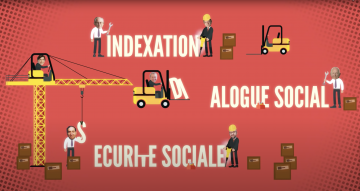Il y a cinquante ans: Le séisme de juin 1967
Événement incommensurable. L’adjectif qu’utilise G. Corm[1] pour qualifier la nationalisation par Nasser en 1956 du canal de Suez – et l’agression perpétrée en riposte par une coalition anglo‑franco-israélienne contre l’Égypte – s’applique tout autant à la guerre de juin ‘67. À onze ans d’intervalle, les deux événements apparaissent d’ailleurs liés. Si les séquelles de l’opération « tripartite » de 1956 portaient en germe le conflit de 1967, la défaite arabe porta un coup mortel aux espoirs arabistes nés avec l’« affaire de Suez ». Et les similitudes entre les deux crises sont nombreuses. À commencer par les motivations israéliennes et la « préparation » de l’opinion qui les ont précédées.
La troisième guerre israélo‑arabe ne se solda pas seulement par la victoire écrasante des armées israéliennes sur les forces de l’Égypte, de la Syrie et de la Jordanie. Ces six jours ‑ du 5 au 10 juin ‑ allaient en effet bouleverser de fond en comble le Proche-Orient arabe et marquer profondément la société israélienne elle-même. Plus, les retombées du conflit allaient affecter l’ensemble du monde musulman. Et, au‑delà, la scène internationale. Coup d’œil rétrospectif sur les effets d’un tremblement de terre.
«Guerre des six jours»: la formule fait désormais partie du vocabulaire historico‑politique courant. Sans que ceux qui l’utilisent ne perçoivent que fort peu ce qu’elle eut d’humiliant pour « les Arabes ». Une formule qui apparaît au demeurant comme le produit durable d’une jubilation intense, partagée à l’époque par les Israéliens comme par de larges fractions de l’opinion occidentale.
Du génocide aux brodequins: la manipulation érigée en art
Qui se souvient encore des couplets dithyrambiques sur l’éclatante victoire du « David » israélien sur le « Goliath » arabe? Une jubilation qui, e. a. en France, avait réuni l’opinion de droite – se sentant vengée par la « raclée » administrée « aux Arabes » cinq ans après la perte de l’Algérie – et une bonne partie de l’opinion de gauche. Rappelons, pour l’une, les commentaires de Paris‑Match sur les soldats égyptiens « retirant leurs bottes pour mieux fuir dans le désert »[2]. Pour l’autre, la campagne médiatique présentant « le petit État juif » comme menacé d’un nouveau génocide vint faire comme un écho à l’équation « Nasser=Hitler » formulée en 1956 par le « socialiste » Guy Mollet[3]. Et force est de constater qu’aujourd’hui encore, ni les analyses, ni les « révélations » faites depuis ne semblent être venues à bout des croyances inculquées à l’époque: quant au déclenchement du conflit, quant à la réalité de la menace arabe, quant aux motivations des protagonistes.
Plusieurs généraux israéliens ‑ et non des moindres ‑ se sont pourtant chargés de démentir, non seulement les allégations d’une menace « génocidaire », mais jusqu’aux intentions arabes d’attaquer Israël. Ainsi, le général Matityahou – Matti – Peled, membre de l’état‑major de Tsahal en ‘67 et qui allait devenir l’un des ténors du pacifisme israélien[4], reconnaissait en 1972 que « la thèse selon laquelle [...] Israël combattait pour son existence physique n’était qu’un bluff ». La même année, Ytzhak Rabin, qui avait commandé ledit état‑major, mettait en doute, dans une interview au journal Ha’aretz, les intentions belliqueuses de Nasser: « je ne pense pas que Nasser voulait la guerre. Les deux divisions qu’il envoya dans le Sinaï le 14 mai, n‘auraient pas suffi pour lancer une offensive contre Israël. Il le savait et nous le savions ». Enfin, quelques années plus tard, Moshe Dayan, ministre de la Défense de l’époque, faisait la part des choses en ce qui concerne le « jusqu’au‑boutisme » syrien, pourtant dépeint comme l’une des raisons majeures des « craintes » israéliennes: « j’ai commis une erreur en permettant la conquête du Golan en juin 1967... J’aurais dû empêcher cela, car les Syriens ne nous menaçaient pas à l’époque »... Des déclarations qui, au regard de leurs auteurs[5], suffiraient en elles-mêmes à démontrer que la guerre de juin ne fut ni une guerre de riposte et de « légitime défense »[6], ni ‑ comme on l’affirma par la suite ‑ une opération préventive justifiée par l’imminence d’une attaque ennemie. Force est toutefois de constater que ces déclarations n’eurent pas l’impact auquel on aurait pu s’attendre.
Piéger Nasser
Le discours, essentiellement travailliste, qui, dès la fin de la décennie suivante[7], allait stigmatiser une «perte d’âme» imputée à l’arrivée au pouvoir de la droite israélienne, n’était certes pas exempt d’arrière-pensées auto-justificatrices. Ni la politique d’expulsion et de colonisation, ni celle des « représailles » ne furent en effet l’apanage de la droite israélienne: en 1977, à la veille de la victoire électorale du Likoud, 11.000 colons étaient déjà installés dans quelque 80 « points d’implantation » au-delà de la Ligne verte. Et, en dépit des mythes nourris à l’époque par la gauche occidentale, divers historiens ont montré toute la relativité du socialisme à l’israélienne[8]. Maxime Rodinson nous rappelle aussi comment, au début des années ‘60, « l’amollissement » d’Israël – indifférence croissante aux idéaux du sionisme, chute drastique de l’immigration juive et exode des cerveaux – s’accompagna d’une popularité croissante de la politique extérieure, plus « conciliante », du gouvernement de Levi Eshkol et de son ministre des affaires étrangères, Abba Eban[9]. Et souleva les appréhensions de milieux militaires et d’une droite travailliste regroupée autour de David Ben Gourion, de Moshe Dayan et de ... Shimon Peres. Dans son livre The Accidental Empire: Israel and the Birth of the Settlements, 1967-1977, le chercheur israélien Gershom Gorenberg[10] montre que les dirigeants travaillistes – Ygal Allon, Yisraël Galili, Golda Meir, Moshé Dayan et Shimon Peres – se sentirent au lendemain de la victoire, brusquement ramenés à ce qu’ils ressentaient comme « les jours Glorieux » de leur jeunesse d’avant la creation de l’Etat. Une ivresse qui, selon Gorenberg, les empêcha de s’opposer aux projets de colonisation des Territoires, même si certains d’entre eux en prévoyaient les consequences. Sans négliger le fait, bien sûr, qu’au sein du Parti travailliste, des personnalités comme Y. Allon ou Y. Galili, issus De l’Ahdut Ha'avoda et du Mouvement unifié des Kibbutzim, ou comme S. Peres et M. Dayan du Rafi[11], n’avaient jamais cessé d’être des partisans du « Grand Israël ».
Dès lors, cette aile « activiste » allait s’efforcer de contrer ce qu’elle considérait comme une « démobilisation » et d’imposer sa ligne. En provoquant – par des déclarations menaçantes et des opérations de « représailles » disproportionnées – le raidissement des voisins arabes[12]. En utilsant aussi au mieux une « rhétorique » arabe – aussi incendiaire qu’insensée – comme une arme de choix pour alimenter les craintes de la population israélienne et se gagner l’opinion occidentale. L’on se limitera ici à rappeler les propos attribués au chef de l’OLP « première mouture »[13], Ahmed Choukeiry, selon qui il s’agissait de « jeter les Juifs à la mer »…
Les « faucons » israéliens réussirent donc à piéger un Nasser acculé aux gestes « forts » par les surenchères et les critiques de ses rivaux arabes. Ainsi, la fermeture par le Raïs du détroit de Tiran, le 23 mai 1967, est aujourd’hui encore présentée comme le casus belli qui rendit inévitable le déclenchement des hostilités. Incontestablement problématique pour Israël[14], le blocage de la liberté de navigation dans le golfe d’Akaba, n’en apparaissait pas moins comme d’autant plus supportable que Washington et Londres avaient multiplié les assurances d’y remédier rapidement. Des pressions auxquelles croyait apparemment Abba Eban. Nasser, par contre, apparaissait comme le grand bénéficiaire d’une mesure éminemment symbolique : en « refermant » le golfe d’Akaba, il retirait à Israël son seul acquis de l’expédition de Suez de 1956. Et montrait par la même occasion sa « détermination » à défendre l’allié syrien[15], clouant le bec à ceux qui dénonçaient son « inaction ». C’est là sans doute que réside l’explication de l’attaque « préventive » israélienne. La troisième guerre israélo‑arabe apparaît ainsi comme le résultat du choix des « faucons » israéliens : celui de l’option militaire afin d’éviter que l’« escalade » égyptienne ne débouche, comme l’espérait Nasser, sur une remise en cause négociée des acquis israéliens de 1948 et de 1956.
Hubris
II reste que la guerre de 1967 sanctionna – ou plutôt accéléra – un « tournant idéologique » en Israël. Les conquêtes israéliennes[16] s’avérèrent en effet rapidement « empoisonnées ». Et particulièrement celle des lieux saints de Jérusalem‑Est et d’Hébron, dont la « libération » allait conférer à la guerre une « signification messianique »[17]. Un « appel de Dieu » qui allait galvaniser le sionisme religieux et stimuler la politique de colonisation des territoires palestiniens. Cette victoire sans précédent – et l’alliance américaine – allaient, d’autre part, développer une euphorie et un sentiment d’invincibilité propices à toutes les intransigeances : un hubris, une démesure qui, selon les Anciens, voue inéluctablement à leur perte ceux dont ils se rend maître.
Curieusement, cette nouvelle « arrogance » – couplée à l’émergence d’une nouvelle génération qui, comme dans les autres communautés juives, s’ouvrait aux souvenirs du génocide hitlérien[18] – allait, face aux critiques de plus en plus nombreuses (et parfois à forte odeur de pétrole) portées à la politique israélienne, favoriser une certaine paranoïa : « le monde entier est contre nous »… D’où le paradoxe d’un renforcement du sentiment obsidional au moment où la puissance militaire israélienne éclatait au grand jour.
Les années d’après‑guerre allaient aussi connaître une prospérité économique accrue, précipitant la désuétude de principes et de « valeurs », nous l’avons vu, déjà érodés. Au ein brera – « c’est la seule solution» – traditionnellement invoqué pour justifier, face aux doutes, la politique arabe d’Israël, devait succéder une réplique moins scrupuleuse: nou!? – « et alors?! »[19]. Enfin, cette prospérité allait souligner les disparités sociales entre une élite ashkénaze et les laissés pour compte sépharades du « miracle israélien ». Évolutions cumulées qui traçaient une voie royale à l’arrivée au pouvoir, dix ans plus tard, de la droite revendiquée.
Vers la « pax americana »
À la faveur de la défaite des « tuteurs » arabes, la guerre stimula le développement d’une résistance palestinienne autonome. Le Fatah se fit le champion de « l’autonomie de décision » palestinienne par rapport aux régimes « frères ». Une vague «marxiste», dénonçant les insuffisance du « socialisme arabe », déferla également sur la région[20]. Juin ’67 fut, enfin, suivi d’une série de bouleversements politiques[21]. Évolutions qui purent laisser croire à une nouvelle radicalisation « à gauche » du monde arabe, mais qui s’avérèrent éphémères. Le « tournant » de 1967 fut en effet essentiellement marqué par la montée en puissance des monarchies pétrolières qui allaient devenir, écrit G. Corm, « les vrais arbitres de la situation dans le monde arabe ». Un « arbitrage » qui, sur le plan international, allait favoriser le recul de l’URSS au Proche‑Orient et les succès de la diplomatie américaine.
Malgré les « trois non » –à la reconnaissance d’Israël, à l’armistice, à des négociations – du sommet arabe de Khartoum (août 1967), les dirigeants arabes réunis dans la capitale soudanaise allaient se priver de leur seul atout. En décidant, conformément aux vœux des pétro-monarques, que « l’arme du pétrole » ne serait pas employée contre les puissances protectrices d’Israël. Khartoum, poursuit Corm, créa donc « une impasse lourde de conséquences », dont Henry Kissinger allait saisir toute la portée. Imposant à la Russie soviétique un retrait du Proche-Orient auquel la Russie poutinienne n’allait mettre fin qu’en… 2015, avec l’intervention en Syrie. Dear Henry allait peu à peu forcer les gouvernants arabes à reconnaître dans les États‑Unis le seul recours sur les plans économique, politique et militaire. Une « impasse » dont Sadate tirerait bientôt les leçons « en se débarrassant des Soviétiques (1973), en intégrant totalement l’Égypte dans le réseau des intérêts américains, puis en allant directement causer avec les Israéliens ».
Ainsi, la guerre de juin 1967 devait accélérer l’instauration d’une hégémonie américaine au Proche-Orient et renforcer une évolution, déjà perceptible auparavant, vers la recherche de solutions politiques au conflit israélo‑arabe. Nombre d’Arabes voulurent d’ailleurs percevoir – pour « expliquer » tant la défaite que l’audace israélienne – « la main de Washington » dans la fulgurance de la victoire de Tsahal[22]. Aux yeux de certains, juin 1967 s’inscrivait dans le contexte d’une « agressivité » croissante des Américains à l’égard des régimes « récalcitrants ». Deux ans après les débuts de l’engagement massif au Vietnam et la liquidation en masse des communistes indonésiens, Washington semblait à présent brandir à nouveau son « gros bâton » en Méditerranée orientale : la guerre n’avait-elle pas suivi de deux mois le coup d’État des colonels grecs, en avril? Et la défaite des alliés arabes de l’URSS ne visait‑elle pas à répondre au renforcement[23] de l’Eskadra soviétique en Méditerranée? Enfin, écrit Henry Laurens[24], avec la guerre menée au Yémen entre l’Arabie saoudite et l’Egypte nassérienne, c’était le sort de
La revanche des «émirs»
La « revanche des émirs » devait également se traduire de façon plus directe. En bouleversant les rapports de forces entre États arabes et, partant, les « modèles » proposés à leurs populations. Le sommet de Khartoum fut aussi le lieu de la « réconciliation » de Nasser avec le roi d’Arabie saoudite. En forçant Nasser à mettre fin à son aventure yéménite – son « Vietnam » – Fayçal l’emportait ainsi dans une guerre où, depuis 1962, s’affrontaient, par yéménites interposés, le « modèle » saoudien, fondamentaliste et pro‑occidental, et le panarabisme laïcisant et socialisant du Rais. Une victoire symbolisée en 1969 par la création, sous égide saoudienne, de la Conférence des États Islamiques. Plus, Fayçal, fort d’une aide financière indispensable à l’Égypte vaincue, allait pousser Nasser à apparaître de plus en plus comme l’ennemi des radicaux « anti-impérialistes ». Au Yémen du Sud comme aux yeux des Palestiniens, qui perçurent son acceptation du Plan Rogers comme un feu vert à leur écrasement par l’armée jordanienne en septembre 1970. Une évolution du régime égyptien que l’émotion suscitée par la mort de Nasser, juste après le « septembre noir »[25], devait partiellement occulter, mais qui n’en fut pas moins évidente. 1967 sanctionna donc non seulement l’échec de l’effort commun arabe contre Israël. II fut aussi un coup décisif porté aux rêves – unité arabe et développement autonome – des années ‘50 et ‘60.
Enfin, le « tournant » de ’67 exprimait et allait accélérer au sein des sociétés arabes des mutations sociologiques profondes.
«Militaro‑mercantilisme»...
Dès 1968, de timides mesures de libéralisation annonçaient l’Infitah – l’« ouverture » économique – de Sadate. Une évolution qui répondait aux desiderata des nouvelles « bourgeoisies d’État » qui, désormais assises, prenaient leurs distances avec les régimes qui les avaient mises en place. Parce qu’inquiètes de la mauvaise gestion de ces régimes qu’aggravaient le poids démesuré des budgets militaires. Parce que désireuses de « jouir de (leurs) privilèges dans un cadre plus libéral »[26]. Une évolution qui correspondait également au déploiement dans tout le Proche‑Orient de ce que Corm décrit comme une classe de « nouveaux entrepreneurs » et de « milliardaires du pétrole » ayant bâti leur fortune en participant au développement économique des pétromonarchies. À la faveur de la fin du nassérisme – mais aussi de celle du « gauchisme » syrien[27] et de l’évolution du régime irakien dans les années ’70 – et de l’afflux des « pétrodollars », ces « milliardaires du pétrole » allaient « investir » des régimes – mais aussi une organisation comme l’OLP – hier radicaux et leur imprimer leurs orientations économiques... et idéologiques[28]. Ce fut, selon le terme d’Elizabeth Picard, l’avènement des « complexes militaro‑mercantiles ».
Résolument libéraux et pro‑américains, parfois sympathisants de la doctrine wahhabite de leurs « parrains » saoudiens, les « nouveaux entrepreneurs » allaient montrer leur « pragmatisme ». Sur le plan économique, en affichant une préférence marquée pour les secteurs rentables à court terme: import‑export, tourisme, bâtiment et travaux publics... Sur le plan politique, tantôt en privilégiant le retour au traditionalisme, voire à la « bigoterie » dans les sociétés arabes, tantôt, face à Israël, en poussant à une décrispation susceptible de fructueuses retombées[29]. « Décrispation » qui connaîtra son point d’orgue au siècle suivant, à la faveur du conflit entre Riyad et Téhéran et d’un « bloc sunnite » contre un « arc chiite ». Conflit qui mènera à un incontestable rapprochement entre l’Arabie saoudite et Israël que les actuelles options de Donald Trump pour le Proche-Orient ne pourront que favoriser davantage.
... et «tyrannie pétrolière»
1967 ouvrit aussi la porte au bouleversement de la scène énergétique mondiale. Autre décision de Khartoum, l’aide fournie aux « pays du champ de bataille » par les pétromonarchies – que le quadruplement des prix pétroliers après la guerre de 1973 avait dotées de moyens financiers accrus – allait, additionnée aux rentrées des émigrés arabes dans les pays du Golfe, faire passer le Proche-Orient « de la tyrannie de la pauvreté à la tyrannie du pétrole »[30].
Les « chocs pétroliers » de l’après‑1973 se révéleraient en effet bien moins délétères pour l’Occident que pour les sociétés arabes, où la nouvelle « gestion », plus libérale et basée sur la rente pétrolière, allait induire des bouleversements lourds de conséquences. Un nouveau cours en rupture totale avec les objectifs, populistes et développementistes, des années ‘50.
L’« ouverture », parfois démagogique, aux biens de consommation modernes et aux capitaux, étrangers et arabes, devait entraîner une inflation tranchant, remarque encore Corm, avec une « stabilité séculaire des prix ». Dans les métropoles arabes, celle‑ci s’ajouta au déchaînement de la spéculation foncière. Couplées à une démographie galopante et à l’exode urbain, inflation et spéculation furent à l’origine d’une crise du logement et d’une baisse des conditions de vie propices à tous les mécontentements, particulièrement chez les jeunes. Devenues hyper-consommatrices, les sociétés arabes allaient bientôt vivre « au‑dessus de leurs moyens », tandis que la priorité accordée aux hydrocarbures et aux services allait bloquer leur développement. Ainsi, l’émigration « sauvage » vers l’Eldorado du Golfe allait provoquer une hémorragie de cadres et d’ouvriers qualifiés. Un exode qui, s’ajoutant aux attraits de la « vitrine » occidentale, entraînerait le déclin des industries locales. Enfin, devenue « secondaire » – face aux secteurs privilégiés et aux possibilités nouvelles d’achats céréaliers à l’étranger – l’agriculture allait connaître un déclin dramatique: renforçant un exode rural qui allait faire basculer la plupart des pays arabes dans la dépendance alimentaire[31]. Au total, conclut Corm – et contrairement aux stéréotypes d’une opulence due au pétrole – le revenu national per capita de l’ensemble du Monde arabe a, si l’on décompte le secteur pétrolier, moins augmenté que celui des autres pays du « Tiers‑Monde » au cours des années 1970‑1980.
Outre le blocage l’un développement réel, outre la dépendance extérieure, la nouvelle gestion allait aussi creuser les inégalités. Alors même qu’aux signes de richesse ostentatoire s’ajoutaient les évidences d’une corruption échevelée. Un processus aggravé brutalement par la chute des cours pétroliers de 1985, qui réduirait drastiquement les capacités des régimes « militaro‑mercantiles » à acheter la paix sociale. Aux frustrations du « petit peuple » urbain déjà évoquées, allaient s’ajouter celles de « classes moyennes » qui, ayant cru toucher au pouvoir sous les régimes précédents, virent de larges fractions d’entre elles marginalisées et appauvries.
Face aux désillusions cumulées des modèles « socialistes » et d’un modèle capitaliste et libéral invoquant volontiers l’islam pour se légitimer, tout était en place pour la surenchère islamique des mouvements « intégristes ». Bénéficiant au départ de la nouvelle hégémonie saoudienne, plusieurs de ces mouvements allaient – suite à la révolution iranienne, à la crise pétrolière de 1985 et à la Guerre du Golfe de 1990 – se retourner contre leurs « bailleurs de fonds ».
Le retour en force de l’islamisme radical apparût ainsi comme une « conséquence mécanique » de la défaite de ‘67. Une défaite qui sanctionna l’échec des modèles « socialistes » et laissa à vif des traumatismes sur lesquels l’évolution des régimes arabes – de Camp David à Oslo – fit l’impasse. Comme en témoigne l’embarras du régime Moubarak fasse aux révélations, en août 1995, du massacre de centaines de prisonniers égyptiens par l’armée israélienne[32]. Un « regain d’islam » qui peut apparaître aussi comme une « contamination » de l’évolution idéologique israélienne: l’image d’Israël, telle que renvoyée par la droite et l’extrême‑droite sionistes, renforça en quelque sorte un discours islamiste qui percevait dans le « modèle ethnico‑confessionnel » la clé de la suprématie « juive ». Une radicalisation qui est, enfin, le produit de la « tyrannie pétrolière » que juin 1967 permit de mettre en place.
Paul Delmotte
Professeur retraité de Politique internationale à l’IHECS, Bruxelles
* Cet article ‑ hormis divers ajouts et modifications ‑ a paru dans le n° de juin 1997 des revues belges Avancées ainsi que dans Points Critiques, n°60, août-septembre 1997
[1] Le Proche‑Orient éclaté, Gallimard, coll. Folio-Histoire, 1999, p.244
[2] Sans se demander, note Lotfallah Soliman (Pour une histoire profane de la Palestine, La Découverte, 1989, p.165), « s’il était possible, au mois de juin, de courir pieds nus dans le désert du Sinaï ». En fait, les prisonniers égyptiens furent forcés de se déchausser de façon à les immobiliser
[3] Dirigeant de la SFIO et président du Conseil français, Guy Mollet fut l’une des chevilles ouvrières de l’alliance franco‑israélienne et d’une politique de force en Algérie. Remarquons que ses slogans de 1956 – Nasser=Hitler, Suez, « nouveau Munich » – resserviront contre Saddam Hussein lors de la Guerre du Golfe
[4] Suivi, d’ailleurs, dans cette voie par sa fille, Mme Nourit Peled-Elhanan…
[5] Pour les propos de Rabin, cf. Alain Gresh & Dominique Vidal, Proche‑Orient, une guerre de cent ans, Éditions Sociales, 1984, p.37 ‑ L’interview de Dayan, accordée au Yediot Aharonot en 1976, n’a été publiée que tout récemment, cf. Libération, 28 avril 1997. Enfin, Jacques Coubard (La guerre des six jours, Éditions sociales, 1973) cite une série d’« aveux » similaires des généraux Weizman, Bar‑Lev et Herzog
[6] Le 5 juin, France-Soir, par ex., titrait en une: «L’Égypte attaque»...
[7] Avec la victoire électorale du Likoud, en 1977
[8] E. a. Mitchell Cohen, Du rêve sioniste à la réalité israélienne, La Découverte, 1990 & Zeev Sternhell, Aux origines d’Israël. Entre nationalisme et socialisme, Fayard, 1996
[9] Israël et le refus arabe, Le Seuil, 1968
[10] Interview de Aryeh Dayan, How the “accidental empire” was born, in Haaretz, 9 mars 2006
[11] Que ces mêmes « activistes » avaient créé en 1964 après avoir fait défection du Parti travailliste
[12] Une politique de provocations également attestée par Moshe Dayan, cf. Le Monde, 1‑2 juin 1997
[13] En 1964, une première Organisation de libération de la Palestine avait vu le jour sous l’égide des régimes arabes soucieux de brandir, chacun pour ses propres intérêts, la « carte palestinienne ». Diplomate au service de l’Arabie saoudite, Ahmed Choukeiry avait été placé à la tête de cette première OLP
[14] Si seulement 5% du commerce israélien transitait par le golfe d’Akaba, l’approvisionnement pétrolier en dépendait cependant à 90%
[15] La thèse d’une manipulation soviétique ayant fart croire à des concentrations de troupes israéliennes menaçant la Syrie est aussi régulièrement réitérée. Outre qu’elle n’a pas été sérieusement confirmée, elle semble avoir pour fonctions essentielles d’imputer – via l’URSS, dont les conseils d’apaisement à ses alliés arabes sont pourtant connus – la cause de l’escalade aux Syriens, ce que dément au demeurant M. Dayan.
[16] Pour rappel, le Sinaï égyptien, le Golan syrien et le reste des territoires de la Palestine mandataire. À la suite de la guerre d’octobre 1973, une portion du Golan sera restituée à la Syrie en 1974. Le reste, vidé des 2/3 de sa population, sera annexé unilatéralement en 1980. Le Sinaï sera rendu à l’Égypte, partiellement en 1974‑75, totalement avec les accords de Camp David (1978)
[17] Cf. Amnon Rubinstein, Le rêve et l’histoire, Calmann ‑Lévy, 1985
[18] C’est en 1961 qu’eut lieu le procès Eichmann
[19] Jacques Derogy & Hesi Carmel, Israël ultra‑secret, Laffont, 1989
[20] Les organisations issues de la radicalisation du Mouvement nationaliste arabe (MNA) nassérien se firent les porte‑parole, de ce « gauchisme » arabe: le FPLP et le FDLP palestiniens, le FNL sud-yéménite, les guérillas du Dhofar, l’OACL libanaise...
[21] Coups d’État en Irak (1968), en Libye, au Soudan et jusqu’en Somalie (1969)
[22] La conviction que les bases US de Libye avaient apporté une aide logistique aux Israéliens fut une des raisons du renversement de la monarchie par le colonel Kadhafi en 1969
[23] Entamé à partir de 1964 (en réponse au déploiement des fusées Polaris de la Vie flotte US), ce renforcement brisait le monopole naval américano‑occidental en Méditerranée orientale – cf. Charles Rizk, Les Arabes ou l’histoire à contresens, Albin Michel, 1992, p.166 & Jacques Thobie, Ali et les 40 voleurs. Impérialismes et Moyen ‑ Orient de 1914 à nos jours, Messidor, 1985, p.199
[24] Nouveaux regards sur la question de Palestine, entretien avec la Revue d’études palestiniennes, n°104, été 2007, pp. 23 et 26-27
[25] Septembre noir verra quelque 235.000 Palestiniens fuir la Jordanie vers le Liban (Cécile Cabour, L’histoire de l’implication américaine, in Cahiers de l’Orient, n°73, 2004, p.16
[26] Charles Rizk, op.cit., p.182‑183
[27] En 1971, le général Hafez Al‑ Assad évinçait définitivement la « gauche baathiste » en Syrie
[28] Cf. Georges Corm, op.cit. et L’Europe et l’Orient, La Découverte, 1991
[29] Cf. Pascal Fenaux & Paul Delmotte, L’après-guerres, in La Revue Nouvelle (Bruxelles), mars 1994
[30] Cf. Georges Corm, Le Proche-Orient... – Outre les conséquences immédiates de la guerre (la fermeture du canal de Suez), 1967 développa une prise de conscience croissante de la spoliation pétrolière, qui s’exprimerait dans les années suivantes
[31] Selon Corm, le Monde arabe, qui produisait dans les années ‘50, 80% de sa consommation alimentaire, en importait 50% au début des années ‘80
Il semble que vous appréciez cet article
Notre site est gratuit, mais coûte de l’argent. Aidez-nous à maintenir notre indépendance avec un micropaiement.
Merci !
[32] Cf. Libération, 6 juin 1997
[1] Cf. Libération, 6 juin 1997
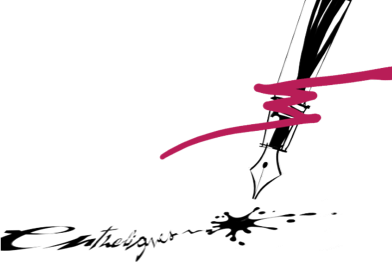
Inscrivez-vous à notre infolettre pour rester informé.
Chaque samedi le meilleur de la semaine.
/ Du même auteur /
-

Palestine : Le principal témoin assassiné
-

Esther et Natalie
-

Hagiographies
-

Guatemala-Israël : d’ « excellentes relations »
-

Israël-Palestine: coupures ombilicales
-

Faut-il renverser les statues d'Abraham Lincoln?
-

Péninsule arabique: la diagonale des Pharisiens
-
La poutre ou la paille
/ humeurs /
/ photos /
/ Commentaires /
Avant de commencer…
Bienvenue dans l'espace de discussion qu'Entreleslignes met à disposition.
Nous favorisons le débat ouvert et respectueux. Les contributions doivent respecter les limites de la liberté d'expression, sous peine de non-publication. Les propos tenus peuvent engager juridiquement.
Pour en savoir plus, cliquez ici.